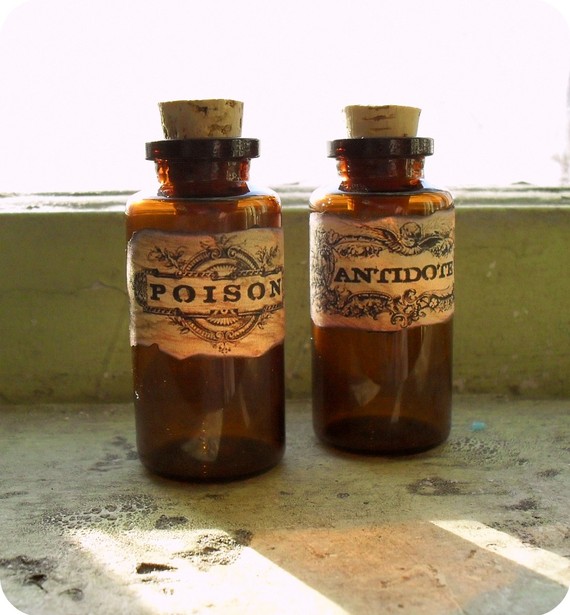La plupart des intoxications aiguës et chroniques ne nécessitent qu’un traitement symptomatique. La mise en oeuvre de techniques spécifiques est rarement utile. souvent associée à un risque iatrogène et/ou a un coût élevé. En revanche, dans certaines intoxications, les antidotes sont des thérapeutiques indispensables ou salvatrices. Leurs mécanismes d’action permettent de les classer en quatre groupes:
1) antidotes formant un complexe atoxique avec le toxique: limitation de l’absorption digestive et accélération de l’élimination,
2) antidotes empêchant le toxique d’atteindre sa cible : accélération de la détoxification et réduction de la synthèse d’un métabolite toxique,
3) antidotes déplaçant le toxique de sa cible,
4) antidotes corrigeant les effets du toxique.
 Le charbon activé est le plus utilisé et le mieux étudié des adsorbants digestifs. À doses thérapeutiques, son efficacité est démontrée vis—à-vis de très nombreuses substances (antidépresseurs tricycliques, digitaliques, aspirine, paracétamol). Il doit être utilisé à fortes doses car l’adsorption est d’autant plus efficace que le rapport charbon/toxique est plus élevé. Administré dans les 5 minutes suivant l’absorption du toxique, le charbon activé peut absorber jusqu’à 90% de la dose ingérée. Ces performances décroissent avec le délai par rapport à l’ingestion. Cependant, lors de l’absorption de certains médicaments possédant un cycle entérohépatique, l’administration répétée toutes les 6 heures pendant les 24 premières heures peut être utile. ll n’adsorbe pas l’alcool, le méthanol, l’éthylène glycol, le lithium ou les métaux lourds. Son efficacité s’exerce évidemment aussi vis—à-vis des médicaments administrés per os, antidotes ou antibiotiques. Son utilisation doit se faire avec précaution en cas d’existence ou de risque de convulsions ou de trouble de la conscience. Le charbon activé est un produit atoxique et peu coûteux. Son intérêt dans le traitement des intoxications aiguës n’a fait l’objet que de très peu d'études cliniques. En pratique, les doses initiales de charbon sont de l’ordre de 50 a‘ 100 g puis elles passent de 20 à 40 g toutes les 4 heures.
Autres inhibiteurs de l’absorption digestive
— Le paraquat et le diquat sont rapidement inactives au contact de montmorillonite (fuller’s earth : terre a foulon) ou de bentonite. Le charbon activé est également efficace.
— Le Sulfate de magnésium transforme les sels de baryum solubles en sulfates, non absorbés dans le tube digestif.
— Le bleu de Prusse (ferrihexacyanoferrate de potassium) séquestre les ions thallium et en empêche l’absorption.
- La Cholestyramine insolubilise les sels biliaires et supprime donc le cycle entérohépatique de certains toxiques : digitaliques, antidépresseurs, etc.
Le charbon activé est le plus utilisé et le mieux étudié des adsorbants digestifs. À doses thérapeutiques, son efficacité est démontrée vis—à-vis de très nombreuses substances (antidépresseurs tricycliques, digitaliques, aspirine, paracétamol). Il doit être utilisé à fortes doses car l’adsorption est d’autant plus efficace que le rapport charbon/toxique est plus élevé. Administré dans les 5 minutes suivant l’absorption du toxique, le charbon activé peut absorber jusqu’à 90% de la dose ingérée. Ces performances décroissent avec le délai par rapport à l’ingestion. Cependant, lors de l’absorption de certains médicaments possédant un cycle entérohépatique, l’administration répétée toutes les 6 heures pendant les 24 premières heures peut être utile. ll n’adsorbe pas l’alcool, le méthanol, l’éthylène glycol, le lithium ou les métaux lourds. Son efficacité s’exerce évidemment aussi vis—à-vis des médicaments administrés per os, antidotes ou antibiotiques. Son utilisation doit se faire avec précaution en cas d’existence ou de risque de convulsions ou de trouble de la conscience. Le charbon activé est un produit atoxique et peu coûteux. Son intérêt dans le traitement des intoxications aiguës n’a fait l’objet que de très peu d'études cliniques. En pratique, les doses initiales de charbon sont de l’ordre de 50 a‘ 100 g puis elles passent de 20 à 40 g toutes les 4 heures.
Autres inhibiteurs de l’absorption digestive
— Le paraquat et le diquat sont rapidement inactives au contact de montmorillonite (fuller’s earth : terre a foulon) ou de bentonite. Le charbon activé est également efficace.
— Le Sulfate de magnésium transforme les sels de baryum solubles en sulfates, non absorbés dans le tube digestif.
— Le bleu de Prusse (ferrihexacyanoferrate de potassium) séquestre les ions thallium et en empêche l’absorption.
- La Cholestyramine insolubilise les sels biliaires et supprime donc le cycle entérohépatique de certains toxiques : digitaliques, antidépresseurs, etc.
Immunothérapie des intoxications
Le traitement des intoxications par des anticorps spécifiques est une idée séduisante dont la réalisation se heurte à plusieurs obstacles :
— la plupart des substances responsables d’intoxications aiguës ont un faible poids moléculaire et ne sont pas immunogènes par elles—mêmes. il faut les fixer à des protéines porteuses pour qu‘elles le deviennent. L'administration à un animal du complexe haptène-molécule doit être répétée pour entraîner la production d‘anticorps ;
les anticorps sont eux—mêmes des molécules de poids moléculaire élevé. fortement immunogènes et non excrétables. Dans la plupart de leurs indications potentielles, ils devraient subir divers fractionnements. avant devenir utilisables.
L'anticorps doit pouvoir accéder aux compartiments où se distribue le toxique : l’immunothérapie est en principe intéressante pour les toxiques à petit volume de distribution ou les toxiques de membrane. Les substances à forte distribution intracellulaire ne sont pas, à priori accessibles aux anticorps.
Les applications toxicologiques actuelles de l’immunothérapie sont peu nombreuses :
— la sérothérapie antivenimeuse est inutile dans la plupart des envenimations par vipères. Elle peut être responsable d'accidents allergiques. Elle ne se justifie que dans les rares intoxications graves. En revanche. elle constitue le traitement des envenimations par serpents exotiques;
— les intoxications aiguës par la digoxine. la digitoxine et le lanatoside C peuvent être traitées par des fragments d‘anticorps Fab. L’immunothérapie antidigitalique est très efficace et bien tolérée ;
— un cas d’intoxication par colchicine a été traité avec succès par anticorps spécifiques ;
— les intoxications par cocaïne et antidépresseurs tricycliques sont à l'étude.
Le Tableau II rapporte la liste des antidotes opérationnels. disponibles 24 heures sur 24 en France, avec leurs indications et leur modalités d’administration.
Formation de complexes atoxiques
Limitation de l’absorption digestive
Charbon activé
Comprimés de Charbon activé
Accélération de l’élimination
Adsorption du toxique circulant sur une colonne d’hémoperfusion En fait, les indications de cette technique sont exceptionnelles. Son risque iatrogène et son coût élevés la font réserver aux intoxications : — par des substances éliminables avec clearance sur colonne élevée; — mettant en jeu le pronostic vital : produit à forte toxicité + intoxication massive + concentration plasmatique élevée + mauvais état clinique + aggravation progressive malgré traitement symptomatique adapté ; — pour lesquelles aucun autre traitement efficaces. moins dangereux et moins coûteux ne peut être mis en oeuvre. Chélation des métaux lourds Les chélateurs sont des substances chimiques formant avec des ions métalliques des complexes stables de faible toxicité et facilement éliminables par voie rénale. Ils sont rarement utilisables au cours des intoxications aiguës par les métaux lourds en raison de l‘atteinte tubulaire sévère et précoce. Le Tableau I indique les principaux chélateurs et leurs indications les plus fréquentes (pour les posologies. voir le chapitre correspondant à chaque toxique). Antidotes des cyanures (EDTA dicobaltique et hydroxocobalamine) L’EDTA dicobaltique (Kelocyanor®) forme avec les ions cyanure des complexes stables (cobaltocyanures) éliminés dans les urines. C ‘est un traitement efficace mais il expose à des accidents thérapeutiques parfois sévères (vomissements, oedème de Quincke, hypotension, hypertension. troubles de l'excitabilité cardiaque, etc.) et d’autant plus fréquents que I'EDTA dicobaltique est administré en l'absence d’intoxication. Pour ces raisons. on lui préfère hydroxocobalamine qui réagit avec l'ion CN- pour former la cyanocobalamine, forme atoxique de la vitamine B12 éliminée dans les urines. Les seules manifestations d’intolérance signalées sont de nature Allergique et exceptionnelles. EDTA dicobaltique et hydroxocobalamine sont des compléments du traitement de l’intoxication cyanhydrique qui est d'abord symptomatique. à base d’oxygène.Tableau I : Principaux chélateurs
| Chélateur | Indication | Effets secondaires |
| Desferrioxamine (Desferal®) | Intoxication aiguë/ chronique par le fer Intoxication chronique par l’aluminium | Réactions allergiques : locales ou générales (rash, hypotension. etc.) par histaminolibération Des troubles digestifs, ophtalmologiques et rénaux ont été rapportés |
| Dimercaprol (B.A.L. ®) | Intoxications par l’arsenic, le mercure, l’or ou le plomb | Douleur au site d’injection, tachycardie, hypertension, collapsus, céphalées, convulsions, troubles digestifs, sueurs, larmoiement, rhinorrhée, paresthésies, fièvre |
| Acide dimercaptosuccinique (DMSA) | Intoxications par le plomb, le mercure et l’arsenic | |
| Dimercaptopropane-sulfonate de sodium (DMPS): Dimaval® (Heyl Berlin) | Intoxications par l'arsenic, le chrome, le mercure et le plomb | |
| EDTA calcique (Calcitetracémate disodique®) | Intoxications par le plomb | Réactions allergiques locales et générales, irritation locale, atteinte rénale |
| Pénicillamine (Trolovol®, Métalcaptase®) | Intoxications par le cuivre, le mercure, l’arsenic ou le plomb | Les troubles digestifs sont les réactions plus fréquentes Rash cutané, Ieucopénie, thrombopénie, hématurie protéinurie, éosinophilie et élévation des enzymes hépatiques sont les réactions graves les plus fréquentes D'autres effets secondaires dont des myasthénies et des insuffisances rénales ont été rarement rapportés |
Neutralisation du toxique avant qu'il atteigne son site d'action (cible)
Activation d’un mécanisme de détoxification
Le paracétamol est partiellement oxyde au niveau du foie en N—acétyl-paraquinone imine (NAPQI). À dose thérapeutique, ce métabolite est rapidement inactive par conjugaison avec le glutathion. En cas de surdosage massif. le glutathion est complètement consommé et l'excès de métabolites entraîne une cytolyse. L‘administration précoce de précurseurs du glurathion (N—acétylcystéine ou méthionine) prévient la déplétion et l‘atteinte hépatique. L’ion cyanure est un poison cellulaire. Il se lie au fer ferrique de la cytochrome oxydase ct bloque la respiration cellulaire. Le complexe cytochrome oxydase- CN- est dissocié par une enzyme, la rhodanèse. qui transfère l'ion cyanure sur un thiosulfate pour former un thiocyanate. Celui—ci. peu toxique. est excrété dans les urines. Le thiosulfate de sodium est très peu toxique. ll est habituellement utilisé avec l‘hydroxocobalamine dans les intoxications cyanhydriques. La S-adénosylméthionine se comporte comme un donneur de radicaux «méthyl ». Elle permet une transformation plus rapide des sels minéraux d'arsenic en dérivés organiques moins toxiques.Réduction de la synthèse d'un métabolite toxique
Les effets toxiques du méthanol et de l'éthylène glycol sont dus à leurs métabolites: l'acide formique pour l'un, acides acide glycolique, glyoxyique et oxalique pour l'autre. La première étape du métabolisme des deux produits est catalysée par la même enzyme: l'alcool déshydrogénase. Elle peut être bloquée par l'administration de substrats pour lesquels l'enzyme a une affinité supérieure à celle du méthanol et de l'éthylène glycol.Déplacement du toxique de sa cible
C'est le mécanisme d'action de nombreux antidotes.Compétition au niveau d'un récepteur
La naloxone (Narcan®) est un antagoniste des opiacés endogènes et exogènes. Elle agit sur d‘intention au niveau des récepteurs. Elle est pratiquement dépourvue d'effets agonistes. Habituellement bien tolérée. Elle est exceptionnellement responsable de troubles de l'excitabilité cardiaque par hyperadrénergisme. Le flumazénil (Anexates®) agit également par compétition avec les benzodiaépines au niveau de leurs récepteurs. C 'est également par ce mécanisme que l'atrophie corrige les effets des parasympathieomimétiques, et le propranolol ceux des bêta-adrénergiques.Oxygénothérapie de l'intoxication oxycarbonée
La toxicité du monoxyde de carbone (CO) est liée à l’anoxie qu‘il entraîne par blocage du transport de l'oxygène (O2) par l'hémoglobine. Le CO a une affinité pour l‘hémoglobine plus de 200 fois supérieure à celle de l'O2. De faibles concentrations atmosphériques de CO sont suffisantes pour transformer une grande partie de l'hémoglobine en carboxyhémoglobine impropre au transport de l'O2. À l'arrêt de l’exposition, la carboxyhémoglobine se dissocie lentement : la demi—vie d‘élimination du CO est de 250 minutes à l'air ambiant. L'élévation de la PaO2 accélère la régénération de l'oxyhémoglobine. La demi-vie du CO n'est plus que de 50 minutes sous 100% d'O2 à 1 atmosphère, de 25 minutes à 2.5 atmosphères.Réactivation des cholinestérases
Comme leur nom l'indique. les anticholinestérasiques inhibent l’activité des cholinestérases. lls produisent une accumulation d'acétylcholine au niveau des recépteurs centraux et périphériques. muscariniques et nicotiniques. d‘où la symptomatologie observée. Les carbamates anticholinestérasiques se lient aux cholinestérases de manière réversible. L’inhibition dont ils sont responsables dure de quelques minutes à quelques heures. L‘intoxication par ces produits ne nécessite qu‘un traitement symptomatique et l'utilisation d’atropine qui permet de corriger les effets muscariniques de l'acétylcholine. En revanche. la liaison des insecticides organophosphorés avec cholinestérases est très stable. La pralidoxime permet, dans certains cas, une réactivation de l'enzyme phosphorylée en se liant avec l‘insecticide. il permet l'hydrolyse de la liaison phosphore-enzyme. La régénération de l'enzyme n'est possible que si les groupements alkyl de l'organophosphoré sont des radicaux méthyl ou éthyl et que l’administration de la pralidoxime est réalisée au cours des 24 premières heures de l’intoxication.Correction des effets du toxique
Les antidotes appartenant à ce groupe sont les plus nombreux ; le Tableau II en donne une liste non exhaustive.Tableau II Antidotes corrigeant les effets du toxique
| Antidote | Toxique | Mécanisme d’action |
| Calcium | Fluorures, acide Correction de la fluorhydrique, acide déplétion en calcium oxalique | Correction de la déplétion en calcium |
| Acide folinique | Antifoliques (méthotrexate, pyriméthamine, triméthoprime. etc.) | Correction de la déplétion en folates |
| Glucagon | Bêta—bloquants | Effet bêta—agoniste par augmentation de la synthèse d'AMPc |
| Glucose | Insuline, sulfamides Correction de hypoglycémiants l'hypoglycémie | Correction de l’hypoglycémie |
| Bleu de méthylène | Méthémoglobinisants Réduction du fer ferrique (nitrites, phénols, de la méthémoglobine amines aromatiques, en fer ferreux monoxyde d'azote, cétrimide, sulfones, chlorates, etc.) | Réduction du Fer ferrique de la méthémoglobine en Fer ferreux |
| Superoxyde dismutase Paraquat et glutathion peroxydase en inclusion liposomale | Paraquat | La vectorisation liposomale permet aux enzymes d’atteindre les poumons et de pénétrer dans les pneumocytes ou' elles suppléent aux systèmes défaillants de I'intoxiqué pour neutraliser des structures radicalaires induites par le paraquat |
| PPSB | Antivitamine K | Correction du déficit en facteurs de coagulation (II, VII, IX et X) |
| Vitamines B6 | Isoniazide, Hydrazine, Gyromitre | Réactivation des systèmes d’enzymes pyridoxinodépendants |
| Vitamine K | Antivitamines K (anticoagulants coumariniques et dérivés de l'indane) | Correction de la déplétion en vitamine K due à l'inhibition par l'anticoagulant de I’époxyde réductase qui assure la régénération de la vitamine K |
Was this article helpful?
YesNo
Last modified: 2 décembre, 2016